A propos de la bataille de la Montagne Blanche - 8 novembre 1620
16.11.2020 / 14:54 | Aktualizováno: 03.03.2023 / 12:09
Une défaite qui a marqué l´histoire et les consciences
Le 8 novembre 1620, il y a 400 ans donc, l´armée dépêchée par l´empereur Ferdinand II et la Ligue catholique a battu sur la Montagne Blanche près de Prague l´armée que lui ont opposé les Etats protestants de Bohême révoltés. Cette défaite au bout d´un affrontement qui a duré à peine 2 heures a eu un impact décisif sur le statut du Royaume de Bohême au sein du Saint Empire et est encore, des siècles plus tard, au cœur de la façon dont une nation moderne, la nation tchèque, perçoit son histoire.
Que nous raconte donc ce récit, que s´est-il passé? En 1618, les Etats de Bohême (parfois appelés la Diète de Bohême), la plus haute instance du pays, disposant entre autre du droit d´élire le roi, composée à ce moment majoritairement de membres de la noblesse non catholique, détrônent le roi qui n´est personne d´autre que le très catholique empereur Ferdinand lui-même. Au roi les Etats reprochent de ne pas respecter les accords concernant les droits des deux confessions et à sa place élisent le comte palatin Frédéric V, chef de l´Union protestante et gendre du roi d´Angleterre Jacques Ier dont par ailleurs ils espèrent le soutien. Le roi-empereur, absolutiste dans l´âme, considère cette élection comme un acte de rébellion et entre les deux camps éclate une guerre dont la bataille de la Montagne Blanche n´est que l´aboutissement.
Rarement une défaite militaire aura autant de conséquences: les 27 principaux instigateurs de la rébellion seront exécutés sur la place de la Vieille-Ville de Prague, entre un cinquième et un quart d´une population de quelque 4 millions d´habitants en Bohême et en Moravie, principalement membres de la noblesse, de la bourgeoisie des villes et du clergé protestant, devront s´exiler s´ils ne voulaient pas se convertir au catholicisme. Ainsi le pays perd-il une grande partie de son élite cultivée. L´usage de la langue tchèque recule et le pays est non seulement recatholicisé de force mais aussi largement germanisé. Il faudra attendre plus d´un siècle et demi pour voir apparaître un mouvement réclamant la reconnaissance des droits de la nation tchèque, d´abord culturels puis politiques.
L´ historiographie tchèque la plus courante, celle qui alimente les romans historiques mais aussi largement les livres scolaires, considère la défaite de la Montagne Blanche comme une tragédie nationale inaugurant une période sinistre dénommée „Les Ténèbres“. Les historiens modernes, plus avisés, combattent une interprétation trop nationale, voire nationaliste, de la bataille elle-même ainsi que des événements qui lui ont fait suite. S´il est vrai que la défaite a eu incontestablement un impact durable sur la civilisation tchèque tout entière et a retardé la formation d´un Etat national tchèque au sens propre, il serait parfaitement anachronique de penser que c´est la nation tchèque en tant que telle qui était visée. La „nation“, au sens moderne de ce terme, à cette époque, n´existait pas à proprement parler et le conflit entre les Etats de Bohême et l´empereur était essentiellement religieux. Enfin les „Ténèbres“ n´étaient pas, selon certains historiens, aussi ténébreuses. Parmi les nobles, les bourgeois, les prêtres catholiques restés au pays il y avait aussi un bon nombre de patriotes authentiques, fidèles à leur langue et à tout ce qui permettra de déboucher au „réveil national“ dès la seconde moitié du 18ème siècle. Autre conséquence: au cours du siècle qui suivra, le pays se couvrira de ces magnifiques édifices baroques, églises et palais, admirés jusqu´à nos jours et qui sont expression de la piété catholique censé de faire front à l´austérité protestante.
Les événements dramatiques des premières décennies du 17ème siècle qui ont eu les provinces historiques de l´actuelle République tchèque pour théâtre sont un moment crucial de l´histoire européenne et c´est à ce titre qu´ils méritent d´être rappelés. Prague, au cœur de l´Europe, a le triste privilège d´être le lieu du déclenchement du premier conflit aux dimensions universelles, préfigurant les guerres mondiales du 20ème siècle. La guerre de Trente ans, dont la révolte des Etats de Bohême et sa suite sur le champ de bataille de la Montagne Blanche sont les événements déclencheurs, a mis à feu et à sang l´ensemble du continent et a fait perdre à l´Europe, selon certaines estimations, jusqu´à 20 % de sa population, alors que dans certaines régions ce chiffre atteint les 60 %.
Les horreurs de la guerre de Trente ans ont allumé aussi, peut-être, une petite lumière dans la conscience des Européens. La religion, la foi, la question quel Dieu est plus juste que l´autre, a petit à petit désormais cessé d´être la principale raison pour laquelle les hommes s´affrontent. Ils ont continué, malheureusement, à se battre dans d´autres combats tout aussi meurtriers mais on peut dire que, du moins en Europe, le fanatisme religieux n´en est plus le principal stimuli déclencheur. Dans un monde où le fanatisme religieux fait des ravages et constitue une des principales menaces à la paix, ce pas vers la tolérance religieuse peut, avec un peu d´optimisme, constituer un progrès.
Pierre Fleischmann, novembre 2020
N.B.
La bataille de la Montagne Blanche, la période dite „bohémienne“ de la guerre de Trente ans ainsi que la guerre entière ont fait objet d´une vaste littérature dans toute les langues d´Europe. Le lecteur français pourrait s´intéresser aux pages que leur a consacré le grand et désormais classique historien de la Bohême Ernest Denis dans sa Fin de l´indépendance bohême (1890). Parmi les écrits français plus récents, la prime revient à Olivier Chaline, La bataille de la Montagne Blanche ( 8 nov. 1620). Un mystique chez les guerriers, Paris, Éditions Noesis, 2000,624 p. ou est analysée non seulement la bataille elle-même mais aussi les traces qu´elle a laissé dans les mémoires des peuples.
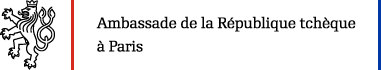




Suivez-nous sur